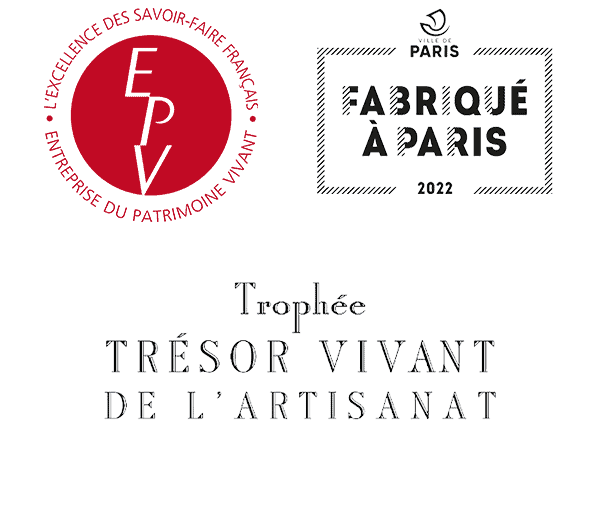L’établissement s’appelait le Jean Bart, longtemps café-tabac, devenue quelques années depuis simple café.

À l’époque, c’était sept ou huit ans en arrière, le nouveau gérant avait tout simplement arrêté la vente de cigarettes. Ça aura éloigné pas mal d’ivrognes et d’enquiquineurs, se justifiait-il. Et effectivement, la première fois qui j’y étais entré, une certaine quiétude m’avait séduit.
Au tout début de mes ennuis, ceux-là même qui furent suivis de la perte de mon emploi, par excès d’optimisme, j’avais la certitude que ça ne durerait que le temps d’un soupir. Aussi l’avais-je caché à mes gosses.
Alors, après, bien que les choses se soient plus durablement installées, il m’était impossible de faire marche arrière. Si bien que la comédie continuait : dans la journée, pour tout le monde, j’étais au travail.
Une difficulté imprévue survint, qui découlait directement de ce mensonge. Des tonnes et des tonnes de dossiers, paperasses en tout genre, qu’il me fallait trouver, constituer, étudier, remplir… et je n’avais tout simplement aucun bureau.
Du fait de la longueur d’une journée à l’école primaire, revenir à la maison était illusoire, et le bureau de Jacques était encore le sien. Un jour, nécessité fait loi, je m’étais installé dans le premier bistro venu.
Jusque-là, je n’aimais pas les cafés, et ne les fréquentais que contraint. Et celui-ci tenait bien ces promesses, sale, puant le tabac froid, éclairage blafard. Je n’arrivais même pas à me concentrer.
Le lendemain je changeais de crémerie, en vain, jusqu’à ce que le hasard me fit un jour tourner à gauche en sortant de l’impasse, plutôt qu’à droite. J’avais trouvé mon « annexe », c’était le Jean Bart.
« L’annexe », dans la grande majorité des professions manuelles, c’était une chose d’importance. Mais au faubourg Saint-Antoine, il semble que ça l’ait été plus encore qu’ailleurs.
D’après le souvenir des anciens, et ce serait confirmer par les archives, il y avait une telle multitude de café, tout au long de la rue de Montreuil, rue qui jus, qu’on les comptait par dizaine depuis la cité de l’ameublement jusqu’au métro. Il faut dire aussi que la clientèle était à l’avenant.
Dans l’immédiat après seconde guerre mondiale, la cité de l’Ameublement abritait plus de deux mille artisans parisiens ou salariés. En fin d’après midi, à l’heure de la fin du boulot, c’était comme dans le film des frères Lumière : un flot ininterrompu.
Au fil du temps, je prenais mes aises. Insensiblement, ma fréquentation du Jean Bart, devint régulière : elle s’était totalement décorrélée du besoin de disposer d’une table et d’une chaise pour pouvoir écrire.
Avec certains autres habitués, qui eux fréquentaient l’établissement de bien plus longue date, des accointances se manifestèrent. Timidement au début, pour petit à petit me voir être admis au sein même cette société informelle qui tous les matins se retrouvait face au zinc pour prendre un « petit noir » .
Au-delà du plaisir, du rituel des retrouvailles matinales et quotidiennes, c’était aussi un réseau d’entraide. Des maintes difficultés que j’avais à appréhender sérieusement pour me préparer à mon futur métier de chef d’entreprise, nombreuses ont été celles qui furent aplanies par l’un ou l’autre d’entre eux.
Ils y avaient d’autres artisans parisiens : ébénistes, tapissiers, vernisseuses… mais aussi un comptable, un avocat, des commerçants, des cadres. Leurs avis ou conseils variés, parfois franchement contradictoires, nécessitaient quelques efforts de discernement, faire le bon tri, mais malgré tout, c’était là un lieu de soutien appréciable et efficace.
Pendant des semaines, par timidité je suis resté à l’écart. Je profitais de la joyeuse ambiance, mais n’y participais pas directement. Un jour, sans que rien ne le laisse présager, on m’avait adressé la parole, explicitement, me prenant à témoin, ou sollicitant un avis, je ne me souviens plus très bien.
Le lendemain, on m’avait serré la main dès mon entrée : j’étais adopté. Désormais, je n’allais plus au « Jean Bart », mais chez « Thierry », le prénom du patron.
Chez Thierry, on y mangeait aussi. Tôt dans la matinée, il s’éclipsait sur son vélo et allait faire le marché : que du frais.
Dans la cuisine, Luisa oeuvrait comme une mère de famille qui doit nourri son monde avec ce qu’elle a sous la main. D’origine espagnole, elle cuisinait comme à la maison, et nous nous en régalions : au menu, un plat du jour, point.
La société du midi n’était pas strictement identique à celle du matin.
D’abord, selon les goûts et les dégoûts des uns ou des autres, selon le menu du jour, selon l’humeur… il y avait des défections, du turn-over. Ensuite, certains habitués du matin étaient des voisins qui prenaient leur p’tit noir avant d’aller bosser, eux, il y avait peu de chance de les voir là un midi, alors qu’en fin d’après midi…
La réalité objective de tout ça, ne se révéla à mes propres yeux que bien longtemps après : pour la première fois de ma vie j’avais des copains de bistrot… Peut-être le passage obligé pour être un authentique artisan parisien du faubourg.